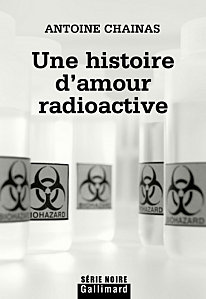Photos : Francesca Mantovani
En neuf romans, la plupart publiés chez Gallimard, Antoine Chainas s’est imposé comme l’un des auteurs les plus intrigants, obsédants, dérangeants de la littérature noire.
Dans son dernier en date, Bois-aux-Renards, Yves et Bernadette sillonnent les routes de campagne dans leur combi Volkswagen le temps des vacances d’été. Des semaines qu’ils attendent, comme chaque année, de quitter leur emploi au supermarché, pour pouvoir s’adonner à leur passion commune, la traque d’auto-stoppeuses et leur mise à mort. Dans une forêt profonde où s’est perdue la jeune Anna, cette dernière perturbe leur rituel. Elle parvient à s’enfuir. Le couple se lance à sa poursuite. Les bois deviennent inextricables. Ils ne sont pas déserts. Chloé recueille Anna tandis que les tueurs trouvent refuge dans une communauté dirigée par Admète et Hermione, duo de vieillards énigmatiques.
Bois-aux-Renards engloutit tous les personnages. Tels les renards qu’elle couve, la forêt apparaît tour à tour protectrice ou hostile. La nature prend le pas sur le monde dit civilisé. Les coutumes anciennes y retrouvent leur place, ainsi que les rituels d’une ère sauvage où la mort fait partie du décor. Chainas déchaîne des forces ancestrales. L’étrange domine. Dans ce conte horrifique, cette histoire labyrinthique, le lecteur, porté par les événements que subissent les différents protagonistes, suit le courant. La structure complexe, faite d’allers et retours, de rêves et de réveils, de souvenirs et d’hallucinations, emprunte les méandres des sentiers tortueux sans jamais nous perdre, impatients autant qu’anxieux de découvrir ce qui nous attend aux détours des chemins. Les révélations que l’on y dépiste nous cueillent, bouleversantes de beauté ou de férocité, troublantes toujours.
Illusions, onirisme. Souffrances que l’on ressent à force de réalisme. Beauté des arbres, des animaux. Tout se mêle, fait écho. A nos doutes et à nos effrois. A notre propre mortalité. Dans cette œuvre majeure englobant tous les thèmes. Qu’on sait qu’on relira. Quand on en aura digéré, une première fois, la vicieuse splendeur.
Les lieux où tu situes l’action de tes romans ont une place primordiale et sont très différents d’un récit à l’autre. Pur se situait dans le sud de la France, dans des propriétés clôturées, code-digitalisées, Empire des chimères dans un village rural en déshérence, Bois-aux-Renards dans une forêt profonde. La genèse d’une histoire naît-elle d’un endroit ?
Je n’irais peut-être pas jusque-là, car dans mon cas l’histoire naît également de personnages, de situations, et aussi de problématiques que je souhaite aborder, d’angles sociaux révélateurs ou de thématiques qui me semblent sous-exploitées. Toutes ces variables ont des importances diverses en fonction du récit, mais il est exact de dire que les lieux ont une place considérable dans chaque roman, certains topoï deviennent même des personnages à part entière. De toute façon, je crois que les environnements définissent autant les individus que les individus ne les définissent. Les urbanistes, par exemple, ont bien compris que les habitats sont révélateurs et révélés. Dans Bois-aux-Renards, la question de l’aménagement ne se pose évidemment pas, puisqu’on se trouve dans un milieu naturel, et même à certains égards surnaturel.
Éprouves-tu le besoin de t’immerger dans les lieux que tu décris ? Par exemple, la forêt de Bois-aux-Renards t’est-elle familière ?
Je ne m’immerge pas particulièrement en ce sens que j’ai une vie intérieure, des souvenirs suffisamment nets pour reconstituer des décors, des lieux que j’ai déjà connus. La forêt de Bois-aux-Renards s’inspire d’une zone des Alpes que j’ai fréquentée assidûment dans ma jeunesse, c’est-à-dire il y a une trentaine d’années, lorsque j’arpentais les sentiers du Mercantour, les gorges de la Roya et la vallée des Merveilles, dont je suis encore aujourd’hui relativement proche géographiquement.

Fais-tu beaucoup de recherches en amont sur l’environnement particulier dans lequel se passent tes romans ? Sur le contexte socio-économique, sur le langage, les spécificités locales ? Le contexte a-t-il une influence sur ton style ?
Même si mes souvenirs et mon ressenti sont nets, j’ai aussi besoin, c’est vrai, d’effectuer de nombreuses recherches pour contextualiser ces souvenirs, pour les articuler avec l’axe central de mon histoire, stabiliser sa colonne vertébrale en quelque sorte. Mon propos ne peut pas se réduire aux impressions du passé ou à l’intuition du présent, j’ai également besoin de densifier le texte en accomplissant un important travail de prospection sur les multiples dimensions du récit. Dans l’idéal, lorsque le livre est terminé, ces différents angles sont autant de portes d’entrée pour le lecteur. Il peut déterminer lui-même les issues qu’il souhaite privilégier pour effectuer son cheminement.
Retravailles-tu beaucoup tes textes ?
En réalité, non. Les éditeurs avec qui je collabore le savent. En général je rends des textes presque « clef en main », je ne peux effectuer que des corrections à la marge. Je ne dis pas que j’y parviens toujours, mais je fais tout en amont pour que les retouches se résument à de la cosmétique, à des détails. Quand le texte est terminé, je n’ai plus vraiment l’énergie, ni la volonté d’y revenir en profondeur. J’espère ne pas choquer les gens, mais pour moi les romans, une fois qu’ils sont écrits, ne sont guère plus importants que des rognures d’ongle. Ils m’ont appartenu au moment où je les ai rédigés, je leur ai donné toute mon attention, mais ils me deviennent étrangers une fois l’histoire bouclée. D’où ma difficulté, sans doute, à m’y replonger, surtout s’il s’agit d’obéir à des impératifs commerciaux, des positionnements marketing sous le verni d’une illusoire perfection.

Bois-aux-Renards relate nombre de contes, de légendes, comme celle de la tour ou du puits. Sont-elles de pures créations ou des reprises de mythes anciens ?
Ce sont en grande partie des adaptations, des assemblages… Il y a eu un gros travail de collecte et d’analyse, pour dégager les motifs communs à tous ces récits et les réinjecter dans le cadre élaboré pour Bois-aux-Renards. De toute manière, il n’existe dans l’absolu aucune création pure. Pour reprendre les mots de Bernard de Chartes, nous sommes tous des nains juchés sur les épaules de géants. Mes géants à moi étaient d’abord les aèdes et les rhapsodes de l’antiquité, puis les Tragiques grecs et les philosophes hellénistiques, ensuite les interprètes des religions du Livre et de certaines croyances orientales, puis ceux d’une partie du folklore européen médiéval, et enfin des littérateurs du XIXe. Tous ont employé en leur temps des ressorts peu ou prou identiques pour susciter l’adhésion, le transport, la conversion, la transe de leur public.
Les renards se prêtent-ils particulièrement à l’élaboration du mystère, de l’étrange ?
Les renards sont des créatures qui peuvent évoquer le mystère, oui, mais seulement parce que dans nos sociétés modernes l’homme a plus que jamais divorcé de l’état de nature. Nous ne voyons plus ni le renard, ni l’animal en général, ni même le vivant comme une dimension essentielle de nous-mêmes. Je crois que l’écologie telle qu’elle est conçue en Occident par la politique et les médias fait énormément de dégâts : elle renforce dans l’esprit des gens une vision dualiste, où il y aurait d’un côté l’homme, et de l’autre une nature qu’il faudrait sensément protéger. L’idée ne date pas d’hier. Aristote disait déjà : « L’homme n’est pas le seul animal qui pense, mais il est seul à penser qu’il n’est pas un animal ». Ne pas voir que l’homme et la nature sont précisément la même chose relève à mes yeux d’une erreur extrêmement préjudiciable. Le renard de Bois-aux-Renards, c’est aussi nous.
De la même façon que les lieux, les époques où se déroulent tes romans sont très importantes. Empire des chimères et Bois-aux-Renards se passent dans les années 80. Pourquoi cette période ?
Je pense que c’est l’époque clef, le moment de bascule où, avec la chute des systèmes alternatifs, le libéralisme s’est présenté comme l’unique voie de salut, le fameux TINA cher au type anglo-saxon. Cette énergie vitale brusquement monopolisée par les chiffres – ceux du gain, ceux de l’argent, ceux de l’algorithme, ceux de la gestion technocratique -, nous nous y baignons aujourd’hui. Pour le pire comme pour le meilleur, car je ne voudrais pas laisser croire que le système n’a que des défauts, loin de là.
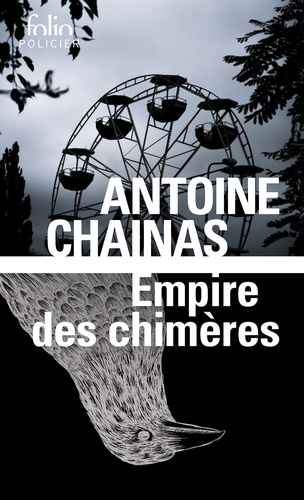
A quel moment et comment choisis-tu les noms de tes personnages. Les prénoms Yves et Bernadette, Chloé, Julien, Désiré, Paul, Gérard ou Admète façonnent-ils leur psychologie ?
À vrai dire, les noms sont choisis au gré de ma fantaisie. Je crois qu’il ne faut pas trop y accorder d’importance, sauf à constater que la plupart des prénoms cités ont une connotation française, pour ne pas dire franchouillarde. Les seules exceptions étant Admète (dans la mythologie thessalienne – chez Euripide par exemple -, c’était celui qui tuait les autres pour survivre ; les lecteurs de Bois-aux-Renards comprendront), et Désiré, le héros d’Anaisthêsia (je ne fais pas de commentaire parce que le lien entre le prénom et le titre me paraît évident si on connaît le sujet du livre).
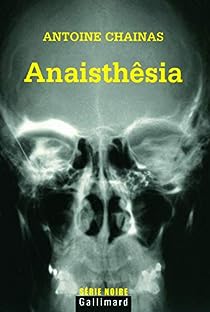
La famille « traditionnelle » est peu représentée dans ton œuvre, ou elle est souvent mise à mal, comme dans Une histoire d’amour radioactive ou Bois-aux-Renards. N’y a-t-il pas de famille heureuse, pas de couple heureux ?
Si, il y en a, mais ils ne sont pas dans les romans, ni dans les œuvres de fiction en général. Le bonheur n’est pas un élément dramaturgique très efficace. Dans le cadre de la fiction et du divertissement, l’intérêt naît du déséquilibre, de la transgression d’une situation initiale stable, que les protagonistes vont tenter de restaurer. Cela reflète, je crois, un combat ordinaire auquel les spectateurs ou les lecteurs s’identifient. Les aventures des dieux eux-mêmes étaient déjà chez les Anatoliens ou les Mésopotamiens remplies de bruits et de fureur. J’aimerais écrire un jour un roman avec une authentique figure du bien, qui traverserait tous les stades et toutes les strates de l’existence, non comme un saint, mais comme un homme conscient de la profonde ambivalence de la bonté. Un homme éveillé à sa contradiction essentielle.
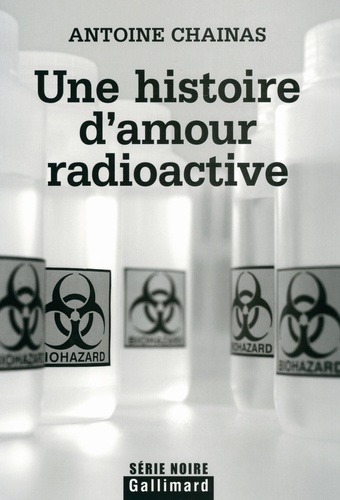
Les femmes de tes romans me semblent présenter des facettes plus complexes de l’âme humaine que les hommes. Premières victimes de la violence de leur monde, comme les filles ramassées par Bernadette et Yves ou comme les enfants de Versus, tu crées en parallèle des figures quasi surhumaines, fantasmagoriques, mystérieuses, oniriques, telle Veronika dans Une histoire d’amour radioactive. Les femmes sont-elles pour toi un moyen d’aborder une transcendance dont les hommes sont incapables ?
Hermione (l’épouse d’Admète) dans Bois-aux-Renards est aussi une incarnation de la transcendance. Mais plus que de transcendance, je crois que je parle d’immanence. Ces femmes ne dépassent rien, elles ont, dès le départ, leur part de divinité. Peut-être en sont-elles simplement plus conscientes que les hommes. Et puis la transcendance laisserait supposer que ce sont des victimes expiatoires. Or il n’en est rien. Que pourraient expier les femmes puisqu’elles ne portent en elle, ni n’effacent, aucune faute ? Il n’y a pas de sacrifice dans la violence qu’elles subissent ou qu’elles infligent, juste l’exercice d’une force. Ce qui montre à quel point on est encore loin des conceptions traditionnelles de bien et de mal.

Bois-aux-Renards, plus encore que Empire des chimères, est un roman labyrinthique, comme s’il n’y avait pas une seule interprétation possible. L’histoire est mouvante, différente selon les lecteurs, selon leur humeur. Aimes-tu laisser la liberté au lecteur de participer à l’élaboration du récit ? Ou est-ce que dans ton esprit ta narration n’a qu’une seule interprétation ?
J’ai déjà un peu évoqué cet aspect dans la troisième question : chacun de mes livres présente, je pense, une multitude d’angles. Au lecteur de déterminer lui-même la porte d’entrée par laquelle il souhaite pénétrer dans l’œuvre. Fondamentalement, je lui fais confiance. C’est un pari et une forme d’exigence. Comme je suis d’un naturel optimiste, j’ose croire que la récompense est au bout de l’effort d’appropriation. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que des romans comme Empire ou Bois réclament une participation active du lecteur, une implication, un engagement. Nous ne sommes pas dans le cadre passif des œuvres qui veulent réconforter et être aimées en retour, comme les livres feel-good qui ont le vent en poupe en ce moment.
Bois-aux-Renards est un roman noir, fantastique, métaphysique, sociologique, un conte philosophique, une romance… Comment le qualifierais-tu ? Cherches-tu à tendre vers un roman total ?
Il y a effectivement une proposition holistique. Pas dans tous mes livres, mais dans Bois assurément, parce que cette proposition correspond à l’essence même des mythes, contes et légendes qui forment la trame du texte. Je crois que je le qualifierais simplement de roman noir teinté de fantastique, même si cette teinte s’exprime moins par des événements inexplicables que par une forte stylisation de la narration.

Certaines scènes dans ton œuvre, très perturbantes, laissent une sensation durable de malaise. Penses-tu à l’impact qu’ont ces scènes sur tes lecteurs ? Qu’éprouves-tu en les écrivant ?
Bien sûr, je mentirais si je prétendais que je ne pense pas, ou que je ne calcule pas précisément l’impact que je cherche à produire avec telle ou telle scène. Mais pour ce qui me concerne, il s’agit avant tout d’une question d’équilibre et de cohérence. Je ne cherche pas à choquer pour choquer, seulement à présenter une œuvre de divertissement offrant une globalité des contrastes, un dosage méticuleux des périodes de tension et d’apaisement. Comme dans la vie, finalement, mais en plus intense. Quant à ce que j’éprouve, c’est plus délicat. Je n’aime pas les sentiments que les scènes violentes font naître en moi, sans doute parce que j’en connais les pièges, mais je sais qu’ils sont nécessaires à l’histoire que je souhaite raconter. Je dirais donc que je m’accommode du plaisir comme de la douleur, de la délectation comme du malaise, qui ne sont, si l’on y réfléchit bien, que des illusions.
La société malmène les individus, et les individus sont cruels envers les plus faibles, enfants ou animaux. La violence est-elle inhérente à l’Humain, quel que soit l’environnement, rural ou urbain, le contexte socio-économique ?
Je dirais surtout que la violence est inhérente à l’ignorance. Comment l’animal raisonnable qu’est l’homme, s’il ne connaît ni son nom exact, ni le lieu où il se trouve, ni le monde où il habite, pourrait-il s’abstenir de prendre par force ou par ruse ce qu’il estime être dans son intérêt ? Bien entendu, la violence n’est qu’un concept, et elle ne se situe pas toujours où on l’attend. Je pense pour ma part que le mal est exclusivement moral, mais c’est un sujet qui est sans doute trop vaste pour être abordé ici.
A te lire, on t’imagine tourmenté. La mort t’obsède-t-elle ? Es-tu quelqu’un de léger au contraire dans la vie ?
Je ne sais pas. Ceux qui me côtoient seraient mieux placés que moi pour vous en parler. J’imagine que je suis un peu comme tout le monde, j’ai des moments de doute, d’autres où je suis plus enjoué. Quant à la mort, elle ne m’obsède pas plus que la vie. L’une et l’autre sont des passages, des états de la matière. Ce sont des manifestations, et en tant que telles, il n’y a lieu ni de les craindre ni de les mépriser. Bon, je ne vais pas donner un cours de philosophie pratique maintenant, mais il me semble que l’existence elle-même s’écoule dans la simplicité et que l’on a besoin de très peu de choses si l’on suit avec fidélité quelques préceptes élémentaires.
Bien sûr, ton œuvre n’est pas seulement noire. Par contraste, les instants de beauté et de joie n’en sont que plus lumineux. Souvent, ce sont des moments prosaïques et fugaces de l’existence qui touchent intensément. Faut-il s’évertuer à saisir chaque instant de bonheur, instants qui sont par essence moins intenses, moins durables que la peine et la douleur ?
Réflexion intéressante. La peine et la douleur sont précisément ce qui ne dure pas si elles sont insupportables, ou supportables si elles durent. Le passé a disparu, le futur n’est pas encore. La seule chose qui nous appartienne en définitive c’est l’actuel. Il n’y a pas besoin de s’évertuer à saisir le bonheur, il est déjà là, comme tout le reste, dans l’ici et maintenant. Il suffit de savoir se rendre présent. Un poème formidable de Rudyard Kipling (« If ») dit en substance : « Si tu sais voir la valeur de chaque seconde, alors le monde sera à toi, avec tout ce qu’il contient. » Attention, je ne dis pas que la souffrance n’existe pas, mais il faut la laisser où elle est, à sa juste place, sans lui adjoindre les emportements de l’imagination.
La communauté de la forêt est menée par Admète, conteur, gourou, qui élabore une sorte de mythe, de religion avec des références, des rites. S’il existe, comment se manifeste ton propre besoin de spiritualité ? L’écriture est-elle une des réponses ? Pourrais-tu vivre sans écrire ?
Au quotidien, ma spiritualité trouve son accomplissement dans la philosophie pratique et dans la méditation régulière. L’écriture ne me semble pas relever de cet exercice, en tout cas pas les textes publiés. Je pourrais fort bien vivre sans écrire, même si écrire c’est aussi vivre. Enfin bon, je ferais simplement autre chose, qui serait aussi la vie.
Yves et Bernadette écoutent Les Vêpres de Rachmaninov pour accompagner leur exaltation. Quelle place occupe la musique dans ta vie ?
Moins importante maintenant qu’il y a quelques années. Il me semble que la musique, l’art en général, a tendance à noyer l’expression de la nature, dont il se veut par ailleurs une imitation. Si l’on désire se mettre à l’écoute de la beauté, pourquoi préférer l’imitation à l’original, la création à la spontanéité, l’orchestration aux accidents ? Un chant d’oiseau, un grondement d’avion ou même le silence seront toujours plus beaux à mes oreilles que la plus exquise des symphonies. Un coucher de soleil, une flaque de boue, plus subtils qu’un tableau de maître. Le voyage d’un insecte, la trajectoire des passants dans une gare, plus palpitants qu’un film sur grand écran. Cela dit, Les Vêpres reste une composition d’une profondeur exceptionnelle.

Tu es l’auteur de nombreuses traductions, comme récemment La série des Six Versions de Matt Wesolowski pour EquinoX ou Blanc d’os de Ronald Malfi pour le Seuil. D’où te vient cette maîtrise de la langue anglaise ? Comment envisages-tu ce travail par rapport à ton écriture ?
J’ai passé quelque temps en Angleterre dans ma jeunesse, et je traduisais également pour des magazines, mais ma maîtrise de l’anglais, et même celle du français, sont loin d’être parfaites. Il ne se passe pas un jour sans que je découvre une subtilité, une tournure jusque-là inconnue. Voilà ce que m’apporte la traduction, elle nourrit mon écriture, elle la sculpte, et en retour mon écriture fortifie la traduction. Je pense que je n’épuiserai pas les possibilités de leur nutrition mutuelle tant qu’il me sera donné d’exercer ces deux activités.
Il s’est passé quatre ans entre Empire des chimères et Bois-aux-Renards. Es-tu déjà plongé dans l’écriture de ton prochain roman ? Ou, comme le lecteur, te faut-il du temps pour t’extirper du précédent ?
À vrai dire, le prochain roman est déjà écrit, mais des problèmes d’agenda en retardent la publication pour l’instant. Quant à savoir si je me détache rapidement d’un texte achevé, je vous renvoie à la quatrième question. Dès que le roman est terminé, il ne m’appartient plus. J’irais même plus loin, il ne me représente plus, du moins en tant que personne. J’ai remarqué que les artistes raisonnent souvent selon un biais qui me semble erroné : ils pensent que leurs œuvres les représentent, qu’elles sont eux, d’où leur accablement ou leur fierté selon qu’on critique ou qu’on encense leur production. Pour moi, l’ouvrage mène une vie autonome sitôt le dernier mot imprimé, j’ai déjà changé au moment de la publication. En tant qu’auteur, il n’a pas plus de signification ni d’importance que des cheveux dans une bonde, si j’avais des cheveux. Notons que je ne suis pas très loin de la prosaïque réalité puisque les livres au pilon sont recyclés… en papier essuie-tout. Cela dit, même si profondément, intimement, le texte ne me concerne plus, je dois le commenter, bien sûr, parce que d’une part, dans le cadre de la promotion cette démarche est souhaitable pour l’éditeur, et d’autre part c’est une manière de continuer à en faire circuler l’énergie initiale.
Interview publiée dans New Noise n°66 – mai-juin – 2023