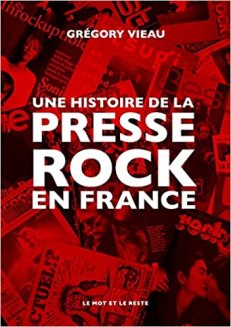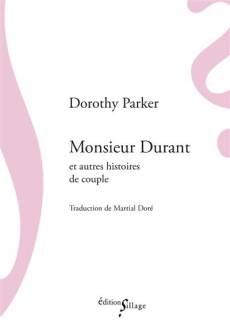Minuscule, très laide et de basse naissance, Petite, de son vrai nom Marie Grosholtz, part dans la vie avec de sérieux handicaps. Orpheline, elle devient la domestique d’un médecin qui ne pratique pas mais reproduit, en cire, les organes humains pour mieux les étudier. Le Dr Curtius l’initie à cet art, pour lequel elle montre de grandes dispositions. Comment faire un moule en plâtre, y couler le précieux liquide, peindre le résultat une fois durci… bientôt, elle dépasse son maître qui profite bien de sa dextérité.
De suisse, ils se rendent à Paris et montent une entreprise de mannequins de cire. Ils y modèlent, d’après nature, les visages célèbres de la capitale : Rousseau, Voltaire… Les gens se pressent pour admirer les bustes des philosophes et surtout ceux des meurtriers les plus terribles, juste avant qu’ils ne soient exécutés. L’Histoire les rattrape. La révolution est en marche. Les têtes tombent. Ils sont sommés de reproduire Louis XVI décapité, Marat assassiné… les moulages des faces sont désormais des masques mortuaires. Petite échappe de peu à la justice expéditive de l’époque et se réfugie finalement à Londres où, à l’âge de 74 ans, elle fonde le musée Madame Tussauds.
Du destin de cette femme exceptionnelle il y avait effectivement de quoi faire un roman. Et quel roman ! Edward Carey, dont on devine les heures qu’il a passées à étudier son sujet, s’affranchit des faits, détourne son œuvre de la simple biographie romancée pour révéler un livre envoûtant, romantique et poisseux.
La mort est partout. Dans les détails des restes humains disséqués par le scalpel du médecin. Dans les rues sanglantes d’un Paris horrifique qui n’épargne personne. Dans les greniers de la maison sous la forme de pantins, de fantômes. Petite survit à tout. A la laideur de son environnement, à la perte des êtres qu’elle a aimés. Et elle décrit, par des mots simples, des réflexions enfantines, ses tourments, ses espoirs et ses craintes, dessinant une héroïne hors du commun, pleine de grâce et de pugnacité.
Petite / Edward Carey, trad. de Jean-Luc Pinningre, Le Cherche-Midi, 2021