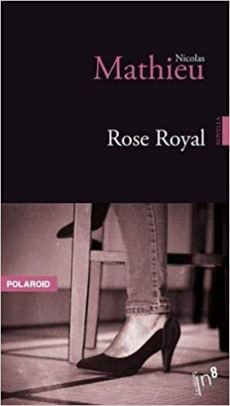Après Trainspotting, Porno, Skagboys, Welsh poursuit, avec DMT, sa saga écossaise. Et si on n’est pas dans le viking, faut reconnaître qu’on est quand même dans le brutal !
Et comment commencer au mieux le quatrième roman (si on écarte L’artiste au couteau, mettant en scène principalement Begbie) sur les quatre magnifiques losers d’Edimbourg ? Par un bon petit coup d’adrénaline !
Imaginez : l’histoire redémarre là où Porno l’avait laissée, ou presque. Begbie s’était fait rouler dessus en coursant le rouquin, qui lui devait du fric. Renton avait passé des années à tenter de ne pas retomber sur le dingue, supposant que sa vengeance serait terrible. Première scène de DMT : Renton est dans un avion au-dessus de l’Atlantique. Et devinez qui se penche sur lui, tel un diable sortant d’une boîte, dans ce lieu clos d’où il est impossible de s’échapper ? Coucou, qui est là ? Le lecteur a quelques longueurs d’avance sur Renton, (et c’est ça qui est bon), car sait que le fou furieux est devenu un artiste dont les œuvres s’arrachent à prix d’or sur le marché de l’art contemporain, et il sait aussi qu’il ne s’est pas assagi autant que ça. Excellente entrée en matière pour un roman qui déroule à grande vitesse une intrigue, sommaire quoiqu’efficace. L’intérêt n’est pas dans l’histoire proprement dite, mais dans le plaisir de voir les anciens potes se rencontrer à nouveau, et celui, évident, de l’auteur à creuser toujours leur psyché et la relation qui les lie.
La vie les avait séparés ; ils ont pris quelques kilos, quelques rides, ils n’ont pas profondément changé pour autant. Sick Boy, toujours latin lover, grand baratineur devant l’éternel, n’a rien perdu de son charme et se sert toujours autant des femmes pour asseoir sa place et sa réputation dans le monde. Il a monté une agence d’escort girls dont il voudrait développer le concept dans sa ville natale. Renton parcourt le monde, manager, nounou de DJs qui ont réussi à faire de lui un homme riche. Spud, toujours à la traîne, toujours dans la dope, clochardisé, mal en point, sempiternel naïf, fait la manche en seule compagnie d’un petit chien qu’il a adopté. Et Begbie sera toujours Begbie.
Les personnages sont comme vivants, anciennes connaissances qui vieillissent en même temps que leur créateur, et que nous. Welsh fouille, dissèque, livrant au passage son lot de scènes impérissables : émouvantes (impossible d’en parler sans trop en dire) et hilarantes – ne jamais se promener au bord d’une falaise en compagnie de Begbie. Ne pas passer une soirée avec Sick Boy si on n‘est pas prêt à en assumer les conséquences. Avec lui, came, cul et embrouilles ne sont jamais loin. Ne pas confier de mission périlleuse à Spud, parce qu’on sait qu’il n’y arrivera pas.
Qu’ont-ils en commun ? Un passé. Une propension à l’addiction. La capacité à se fourrer dans des coups bien foireux. Et une ville, Edimbourg, dont on ne s’évade jamais complètement.
Vieillir, qui a dit que c’était ennuyeux ? Qu’on était obligés de devenir mature, adulte, responsable ? Prendre de l’âge en bonne compagnie est un pur bonheur. C’est rassurant et on espère qu’Irvine Welsh poursuivra son épopée très longtemps encore.
DMT / Irvine Welsh. Trad. de Diniz Galhos. Au diable Vauvert, 2019