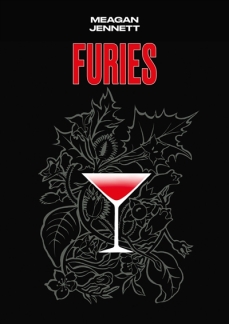Elle s’apprête à concourir pour gagner le titre de Madame Univers. Après des mois d’un travail acharné à modeler son corps pour qu’il se plie à des standards stricts, Dorothy Turnipseed (graine de navet), devenue Shereel Dupont, pseudo beaucoup plus classe, va enfin accéder à la gloire. Rien ne la prédisposait à intégrer le milieu si fermé des bodybuilders pourtant. Il a fallu sa rencontre avec Russell, ancien champion de la discipline, pour qu’elle quitte sa Géorgie natale et se retrouve sous les feux des projecteurs, dans cet hôtel de Miami accueillant la compétition internationale. Elle est près du but, surveillée par son entraîneur, si proche de la victoire… C’est sans compter l’arrivée de sa famille de ploucs et de son petit ami, Clou.
Crews est un maître en son domaine : la peinture d’un univers inconnu (ici celui des compétitions de body-building) et la galerie de personnages improbables mais crédibles qui vont avec. Les gens bizarres ont toujours eu sa préférence. Ils permettent de tant dire sur cette Amérique en dehors de laquelle ils n’existeraient pas, et sur ceux qui les jugent. Dans Body, roman jubilatoire, au rythme effréné porté par des dialogues hallucinants, il porte le cursus au-delà des limites. Confronté à deux univers dont on ignore tout, on poursuit la lecture, bouche ouverte, yeux écarquillés, rictus au coin des lèvres.
D’un côté, Shereel et Russell, ainsi que toute la gamme des compétiteurs et des juges officiels, avec leurs rituels absurdes, leurs manies empreintes de superstition, leur désir d’exhiber ou noter ces corps transformés, transcendés au prix de souffrances continuelles. De l’autre, les parents de la championne, obèses, vulgaires, alcolo, ignares autant que le lecteur des règles de cet art et de la bienséance la plus rudimentaire. Dans le huis clos d’un complexe hôtelier luxueux, tous jurent autant qu’une fanfare au sein d’un orchestre symphonique. La famille, tonitruante, débraillée, exubérante, trouve vite ses marques dans ce nouveau monde – bouffe, cocktails, sexe. Earline, la sœur, exhibe ses 140 kilos comme le font les compétitrices, dans un maillot de bain ne laissant que peu de place à la pudeur et trouve l’amour dans les bras de Bat, bodybuilder incapable de résister à ses rondeurs. Clou, vétéran du Vietnam, parade, distribue des baffes et menace quiconque s’approche trop près de sa fiancée, sans se douter des parties de jambes en l’air qu’elle exécute, telles des figures imposées, avec Russell.
Ça gueule, ça se bouscule dans les couloirs feutrés tandis que les adeptes de la gonflette tentent de se concentrer, tout en usant de toutes les bassesses possibles pour éliminer leurs rivaux. On rit beaucoup, très fort, trop fort. Le dénouement surprend autant que les scènes de fesse. Il percute et rappelle que chez Crews sous l’outrance se cache une réelle finesse, un désespoir profond, un vrai amour pour ces personnages décalés, cabossés. Et on reste là, comme deux ronds de flan, abasourdi après tant de chaos, de bruit, de fureur, peu soucieux que quiconque s’émeuve de nos yeux humides et de la morve qui nous coule du nez.
Body, de Harry Crews
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Philippe Rouard
Gallimard (La noire), 1994